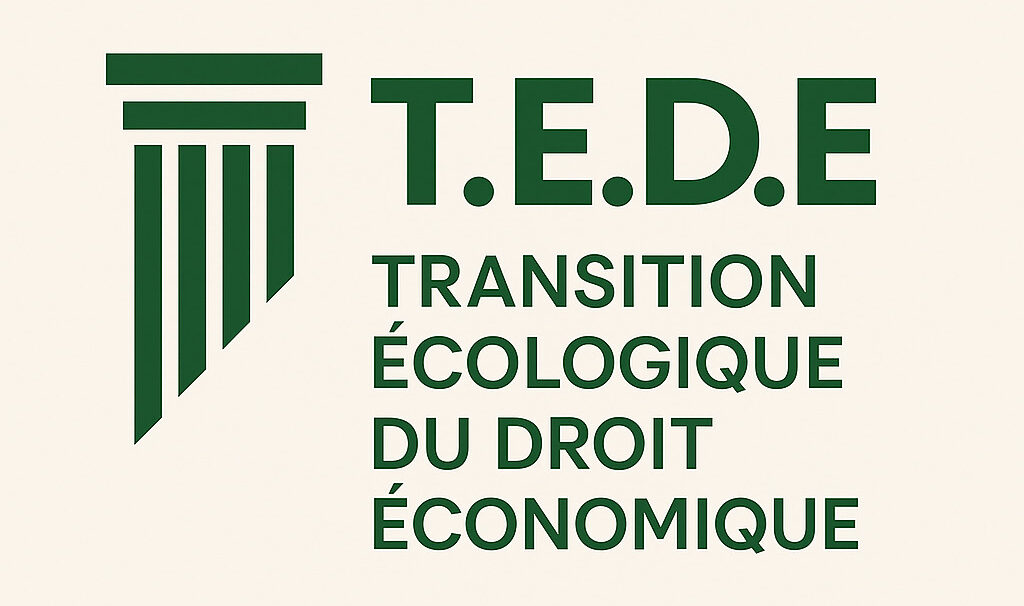La transition écologique et l’enseignement du droit économique. Acte 2 (2025)
En résumé
Un colloque intitulé “La transition écologique et l’enseignement du droit économique. Acte 2” se tiendra à l’Université Côte d’Azur (Nice) le 17 octobre 2025.
Cet événement est destiné à poursuivre une réflexion sur la manière dont le droit économique est enseigné face aux défis de la transition écologique.
Un premier colloque s’était tenu sur ce thème à l’École Normale Supérieure en octobre 2023, dont les actes ont été publiés par la Revue internationale de droit économique. Le colloque du 17 octobre 2025 se présente comme la suite de ce premier colloque.
L’objectif de ce second colloque est de prendre la mesure des initiatives engagées en vue de transformer l’enseignement du droit économique à l’aune de la transition écologique. Il s’agit de mettre au jour les visées et les contours de ces initiatives, d’explorer les contraintes auxquelles leur développement se heurte et d’identifier les ressorts de leur bon développement dans un paysage universitaire complexe et compétitif.
Le programme du colloque sera disponible sur ce site à la fin du mois de juin 2025.
En attendant, retrouvez ci-après une note de présentation du contexte de l’événement et ici un questionnaire sollicitant votre avis sur les évolutions de l’enseignement du droit économique face à la crise écologique et l’impératif de transition.
Contexte de l'événement
Un devoir d’écologiser l’enseignement juridique. Quantité de voix se sont fait entendre ces dernières années afin de pousser les établissements d’enseignement supérieur à se transformer en réponse à la crise écologique. L’Accord de Grenoble, signé en 2021 par plusieurs établissements d’enseignement supérieur et organisations étudiantes, affirme le caractère urgent et transversal des transformations à opérer en la matière. Il invite les établissements à modifier non seulement leurs maquettes pédagogiques, mais aussi leur gouvernance, leurs modes de production des savoirs et leur rapport à la société. Le rapport Sensibiliser et former aux enjeux de la transition écologique et du développement durable dans l’enseignement supérieur, remis au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en 2022, ainsi qu’une note de Cadrage et préconisations du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en 2023 vont encore plus loin. Ils appellent à une intégration transversale et systématique des enjeux environnementaux dans toutes les formations, y compris juridiques, afin de dépasser le seul recours à des modules optionnels. Le ministère, dans son Plan climat-biodiversité de l’enseignement supérieur et de la recherché, publié en 2023, a quant à lui fait de la transition écologique une priorité nationale pour les formations universitaires. Ce sujet devrait donner lieu à l’enseignement d’un socle commun de connaissances que chaque étudiant du supérieur devrait maîtriser. Dans le même temps, le cadre juridique a évolué pour faire de l’éducation à l’environnement, au développement durable et à la transition écologique un sujet d’étude obligatoire à tous les échelons du système éducatif. L’enseignement du droit est donc désormais tenu d’intégrer les enjeux de durabilité.
L’écologisation de l’enseignement du droit économique, source de débats. Le principe même d’une transformation de l’enseignement juridique au nom de la durabilité prête à discussion. La portée et les limites de la liberté académique s’en trouvent questionnées. Des discussions ont cours sur la place des enseignements liés à la durabilité dans l’offre de formation. Ces dernières décennies, la tendance a été de loger les enseignements sur les enjeux de durabilité dans des cours optionnels et spécialisés dispensés au niveau Master, par exemple à travers des cours de Master 1 ou 2 sur le Droit de l’environnement, voire des Masters spécialisés dans ce domaine. Cette structuration traditionnelle répondait à une double tendance. D’une part, contrairement à la conception qui l’a vu naître, le droit économique a été de plus en plus assimilé à un droit des affaires, structuré autour d’objectifs de performance économique et financière et de promotion des droits et libertés économiques des entreprises (protection de la propriété, liberté d’entreprendre, etc.). D’autre part, les spécialistes du droit de l’environnement insistaient, dans ce contexte, sur l’importance de concevoir le droit de l’environnement comme un droit aux finalités strictement écologiques. L’aggravation de la crise écologique est cependant venue mettre en question cette structuration des parcours et des savoirs correspondants. D’un côté, il est de plus en plus difficile de traiter les enjeux écologiques comme extérieurs au périmètre des formations juridiques de base, en particulier en droit économique. En effet, la dégradation de l’environnement plonge ses racines dans les activités économiques et dans leur organisation juridique. La transformation du droit économique – et de son enseignement – apparaît dès lors comme une condition de la transition écologique. De l’autre côté, l’évolution actuelle de la réglementation environnementale montre combien celle-ci est poreuse aux intérêts de certains acteurs économiques, et combien son degré d’ambition écologique dépend de la capacité de faire au préalable émerger des modèles d’affaires plus durables. Le grand partage entre droit économique et droit de l’environnement semble ainsi entré en crise. Pour autant, tous les enseignants sont loin de s’accorder sur le sens de l’intégration des enjeux de durabilité dans les parcours en droit économique. Pour certains, c’est un passage obligé pour rendre compte des évolutions du droit positif intervenues ces dernières années. Pour d’autres, c’est l’occasion d’insuffler un tournant plus théorique, critique, interdisciplinaire et prospectif dans l’enseignement juridique.
L’écologisation en cours des parcours et supports pédagogiques en droit économique. Les parcours d’enseignement et les supports pédagogiques évoluent pour laisser une place de plus en plus grande et visible aux nécessaires synergies entre droit économique et droit de l’environnement. Des masters transversaux conjuguant droit économique et droit de l’environnement, des cliniques juridiques dédiées à la transition écologique ou encore des réflexions sur des supports et des méthodes pédagogiques plus interdisciplinaires font leur apparition. On trouve déjà un nombre croissant de manuels en droit économique qui accordent une place significative aux enjeux de durabilité, notamment sur le plan environnemental. Des ouvrages évoquent désormais la complémentarité entre régulation économique et protection de l’environnement. D’autres intègrent les enjeux écologiques à leur structure même. Un ouvrage de droit international économique, publié en 2023, propose par exemple de refonder entièrement la discipline à partir notamment de l’objectif de transition écologique.
Une dynamique hétérogène, inaboutie et qui se heurte à des obstacles. La dynamique à l’œuvre n’a pas atteint la même ampleur dans tous les champs du droit économique, et elle n’est sans doute pas aboutie. La division traditionnelle du droit public et du droit privé continue de marquer l’imaginaire des juristes. L’enjeu écologique demeure marginal dans la préparation des concours ouvrant l’accès aux métiers du droit – le Barreau (CRFPA), la magistrature (ENM), l’enseignement (Agrégation)… En définitive, les enjeux écologiques, de durabilité et de transition, infusent de plus en plus les enseignements en droit économique, sans qu’on soit encore en capacité de prendre toute la mesure du phénomène et d’en cerner les incidences.
Comité de pilotage
Marie-Alice CHARDEAUX, Maître de conférences HDR, Université Paris-Est Créteil
Florian COUVEINHES-MATSUMOTO, Maître de conférences HDR, ENS-PSL
Aude-Solveig EPSTEIN, Maître de conférences à l’Université Paris Nanterre, Visiting Associate Professor à NYU Abu Dhabi
Maxime LASSALLE, Maître de conférences à l’Université Bourgogne Europe
Gilles J. MARTIN, Professeur émérite de l’Université Côte d’Azur
Irina PARACHKÉVOVA-RACINE, Professeure à l’Université Côte d’Azur