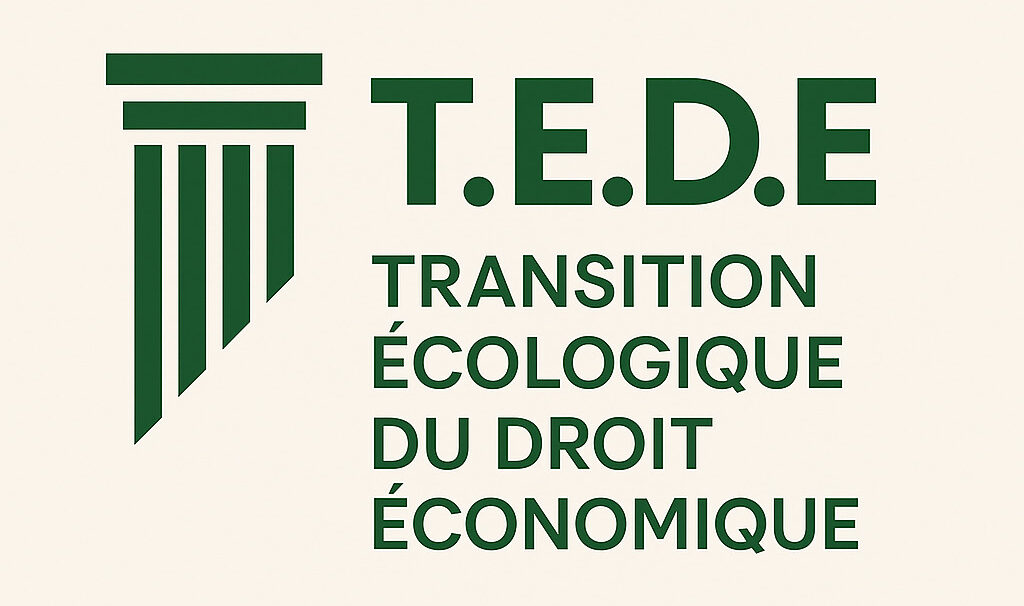Aude-Solveig Epstein
Maître de conférences en droit privé
Aude-Solveig Epstein est maître de conférences en droit à l’Université Paris Nanterre et professeure associée invitée à NYU Abu Dhabi. Ses recherches portent sur les intersections entre le droit économique, le droit de l’environnement et le droit de l’animal. À travers ses travaux, Aude-Solveig Epstein a exploré les fondements, les méthodes et les conséquences de l’implication croissante des acteurs privés dans la création et l’application des normes environnementales, abordant des sujets tels que la responsabilité sociale des entreprises, l’investissement ESG, les litiges environnementaux privés et les droits du public à l’information et à la participation en matière environnementale. Son ouvrage Information environnementale et entreprise : Contribution à l’analyse juridique d’une régulation (L.G.D.J., 2015) examine de manière critique l’émergence d’une nouvelle forme de gouvernance environnementale reposant principalement sur la production et la diffusion de données concernant les impacts environnementaux des entreprises. Il s’est vu attribuer le Prix Louis Joinet dans la catégorie « Droit privé : concepts fondamentaux et droit comparé ». Elle a initié et co-dirige l’équipe de recherche TEDE sur la transition écologique du droit économique. Dans ce contexte, Aude-Solveig Epstein a co-dirigé les ouvrages : Le droit économique de l’environnement : Acteurs et méthodes (Mare & Martin, 2023) et Le droit économique, levier de transition écologique ? (Bruylant, 2022). Elle a également coordonné le numéro spécial de la Revue internationale de droit économique consacré à « La gouvernance d’entreprise soutenable » (2021). Elle a enfin été l’autrice principale du rapport sur La transformation écologique du droit économique, à paraître en 2025. Ses travaux ont également introduit des perspectives innovantes sur les interactions entre le droit de l’animal et le droit économique. Elle a notamment co-dirigé Animal Protection in the EU: The Untapped Potential of Economic Law, à paraître chez Palgrave MacMillan en 2025. Ses recherches actuelles explorent comment le droit peut orienter le développement des technologies et des données pour favoriser des résultats durables (par exemple : « Environmental Law and Technology: A Research Roadmap », in J. van Zeben & C. Hilson (éd.), Research Agenda for Environmental Law, E. Elgar, 2024). Aude-Solveig Epstein est membre du conseil d’administration de l’Association internationale de droit économique (A.I.D.E.), du comité de pilotage du réseau de recherche Sustainable Market Actors (SMART), du bureau exécutif de l’Association des enseignants de droit de l’environnement dans les universités du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (ASSELLMU), et de la Commission mondiale de droit de l’environnement de l’UICN. Aude-Solveig Epstein est titulaire d’un master en droit économique de l’École de droit de Sciences Po et d’un doctorat de l’Université Nice Sophia Antipolis, sous la direction du Professeur Gilles J. Martin.

Gilles J. Martin
Professeur émérite de droit privé
Gilles J. Martin est Professeur émérite à l’Université de Nice Sophia-Antipolis, ancien professeur associé à Sciences Po Paris et ancien avocat au barreau de Nice. Ayant soutenu en 1976 une thèse de doctorat sous la direction de Gérard Farjat, « père » du droit économique en France, sur les relations entre le droit de la responsabilité civile et le droit de l’environnement, il a consacré une grande partie de ses recherches ultérieures à étudier des questions situées à l’interface du droit privé, du droit économique et du droit de l’environnement. Il a soutenu dans tous ses écrits que le droit consacré à la protection de l’environnement ne pouvait pas être seulement un droit de police administrative et il a forgé dans cet esprit la notion de « droit économique de l’environnement ». C’est sous cet intitulé qu’il a créé un enseignement de Master 2 consacré à ces questions à Sciences po Paris à partir de 2008. Il a dirigé de nombreuses thèses sur ces thèmes (parmi les plus récentes : Julie Malet-Vigneaux, L’intégration du droit de l’environnement dans le droit de la concurrence (2014) ; Aude-Solveig Epstein, Information environnementale et entreprise : Contribution à l’analyse juridique d’une régulation (2015) ; Jennifer Bardy, Le concept comptable de passif environnemental, miroir du risque environnemental de l’entreprise (2018). Il a publié de nombreux articles consacrés à l’identification et à l’enseignement du droit économique de l’environnement, à la recherche dans ce champ, ainsi qu’à des questions particulières entrant dans cette thématique, y compris, parmi les plus récentes : « Qu’est-ce que le droit économique de l’environnement ? », in Le droit économique, levier de la transition écologique ? (A.-S. Epstein et M. Nioche, dir), Bruylant 2022, p. 61-73 ; Droit et économie de la transition écologique : Regards croisés, (en collaboration avec Jean-Luc Gaffard), Mare & Martin, Paris 2023, 168 p ; « Le droit économique au service d’une protection sérieuse de l’environnement », in Florilèges du droit de l’environnement (F. Boivin et C. Huglo dir.) édit. Mémoire du Droit 2024, pp. 557-570 ; ou encore « Droit de l’environnement, négociation et représentativité – Variations sur la rencontre entre négociation « écologique » et « négociation sociale », Revue Justice & Cassation 2024, p.101-111. A son départ à la retraite, ses collègues lui ont consacré des « Mélanges » précisément intitulés « Pour un droit économique de l’environnement – Mélanges en l’honneur de Gilles J. Martin ».
Marie-Alice Chardeaux
Maître de conférences en droit privé

Marie-Alice Chardeaux a soutenu une thèse sur Les choses communes, à l’Université de Paris I Panthéon-Sorbonne, sous la direction du Professeur Grégoire Loiseau, Sa thèse a été honorée d’une subvention de l’Université de Paris I, couronnée par un prix de l’Académie des sciences morales et politiques (Prix Araxie Torossian) et sélectionnée pour être publiée à compte d’éditeur par les éditions LGDJ. Après son doctorat, Marie Alice Chardeaux a été recrutée comme Maître de conférences à l’Université de Paris-Est Créteil (UPEC). Elle est membre du Laboratoire de droit privé (LDP). Ses travaux sont consacrés aux communs et à leurs déclinaisons, telles que les choses communes, les biens communs ou les patrimoines communs. Ses travaux embrassent des objets d’une grande diversité : l’eau, l’air, la mer, le climat, les grands fonds marins, en passant par les idées, les inventions dans le domaine public, les creative commons ou les grottes ornées. Ses recherches se situent ainsi au carrefour du droit civil, du droit de la propriété intellectuelle et du droit de l’environnement. Au cœur de ses travaux, une réflexion sur ce qui est ou doit être commun. Dans le prolongement de sa thèse, elle suggère de relire, voire de reconstruire certaines catégories juridiques porteuses d’un intérêt collectif, afin de les faire tendre vers plus de commun. Elle participe, dans le cadre du CNRS, Centre Internet et société, à un Groupement de Recherche (GDR) sur les « Communs numériques et de la connaissance ». Par ailleurs, elle a été membre du projet de recherche, financé par la Mission droit et justice, portant sur « Les biens communs », dirigé par le Professeur Judith Rochfeld (2017-2021). Elle a également participé au Dictionnaire des biens communs, dirigé par M. Cornu, F. Orsi et J. Rochfeld.
Equipe de recherche (par ordre alphabétique)
- Jennifer Bardy, Maître de conférences en droit privé à l’Université Côte d’Azur
- Olivera Boskovic, Professeure de droit privé à l’Université Paris Cité
- Hubert Bosse-Platière, Professeur de droit privé à l’Université de Bourgogne
- Maxime Brenaut, Professeur de droit privé à l’Université de Bordeaux
- Raphaël Brett, Maître de conférences en droit public à l’Université Paris-Saclay
- Juliette Camy, Docteure en droit privé, Chercheuse à la Chaire Droit de la consommation de l’Université de Cergy-Pontoise
- Michel Cardona, Expert associé auprès de l’Institut pour l’Economie du Climat- I4CE, membre du Comité scientifique et d’expertise de l’Observatoire de la Finance Durable
- Arnaud Casado, Maître de conférences en droit privé à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
- Walid Chaiehdloudj, Professeur à l’Université Côte d’Azur
- Florian Couveinhes-Matsumoto, Maître de conférences en droit public à l’Ecole Normale Supérieure
- Arnaud de Nanteuil, Professeur de droit public à l’Université Paris-Est Créteil
- Isabelle Doussan, Directrice de recherche à l’INRAE
- Jean Luc Gaffard, Professeur émérite en sciences économiques, Université Côte d’Azur
- Sophie Grosbon, Maître de conférence en droit public à l’Université Paris Nanterre
- Marie-Angèle Hermitte, Directrice de recherche au CNRS en retraite, Directrice d’études à l’École des hautes études en sciences sociales
- Julien Lagoutte, Maître de conférences en droit privé et sciences criminelles à l’Université de Bordeaux
- Maxime Lassalle, Maître de conférences en droit privé à l’Université de Bourgogne
- Frederic Marty, Chargé de recherche au groupe de recherche en droit, économie et gestion (GREDEG) de l’université de Nice Sophia-Antipolis et au centre national de la recherche scientifique (CNRS)
- Eva Mouial, Professeure de droit privé à l’Université Côte d’Azur
- Irina Parachkévova-Racine, Professeure de droit privé à l’Université de Côte d’Azur
- Béatrice Parance, Professeure de droit privé à l’Université Paris 8 Vincennes Saint-Denis
- Thomas Perroud, Professeur de droit public à l’Université Paris Panthéon-Assas
- Jérôme Porta, Professeur de droit privé à l’Université de Bordeaux
- Jean-Baptiste Racine, Professeur de droit privé à l’Université Paris Panthéon-Assas
- Rémi Radiguet, Maître de conférences en droit public à l’Université de La Réunion
- Sabrina Robert, Professeure de droit public à Nantes Université
- David Robine, Professeur de droit privé à l’Université de Bordeaux
- Judith Rochfeld, Professeure de droit privé à l’Université Paris Panthéon-Sorbonne
- Jean-Philippe Robé, Docteur en droit, avocat aux barreaux de Paris et de New York (Gibson Dunn) et chargé de cours à l’école de droit de Sciences Po
- Tatiana Sachs, Professeure de droit privé à l’Université Paris Nanterre
- Laurence Scialom, Professeure d’économie à l’Université Paris Nanterre
- Marina Teller, Professeure de droit privé à l’Université Côte d’Azur
- Aurélie Tomadini, Maître de conférence en droit public à l’Université de Bourgogne
- Cyril Wolmark, Professeur de droit privé à l’Université Paris Nanterre